
Esprit guinguette
Origine...
Du Moyen Âge au XVe siècle, la vigne étale ses rameaux sur toute l’Île-de-France. Charonne, Montmartre -Belleville sont des vignobles réputés, où s'installent les guinguettes.
Au XVe
siècle, les vignes de Suresnes ne fournissent du vin blanc. Les
vignerons franciliens ne se convertiront dans le rouge qu’au XVIe
siècle, époque où il apparaît comme un breuvage fortifiant, plus
réparateur que le blanc!
Au XIXe siècle, ce n’est plus du guinguet, mais du
vin rouge tout aussi aigrelet, le “bacco”.
On se rend dans les
guinguettes de Suresnes en bateau à vapeur pour y boire de ce petit
bleu.
Le développement du chemin de fer et des canaux facilitant le
transport du vin, et la surproduction des vins du Midi au début du
XXe siècle, entraînent la chute des vignes franciliennes,
aujourd’hui grignotées par le béton.
Cependant, depuis les années
70. la vigne regagne du terrain. “Qui boit une pinte de vin de
Montmartre en pisse quatre !” disait-on dans les estaminets.
C’est
tout dire sur la qualité de ce guinguet pointu et
acerbe...
Voici
les guinguettes qui resurgissent au fil de l’eau, plus primesautières
que jamais.
Au-delà du cliché en noir et blanc, on y découvre un
monde bigarré, des mordus du swing, des fanas de la java, des
accrocs de la pêche.
La
guinguette est du dernier cri !
On y guinche furieusement. On y
sirote une petite java entre 2 verres de muscadet. On y mange sur
fond de lampions et de flonflons.
Lorsque l’été fleurit, lorsque
l’automne s’étire paresseusement aux derniers rayons de soleil,
la guinguette ouvre grand ses portes et laisse s’échapper
senteurs de grillades et notes d’accordéon. L’ambiance est au
pique-nique.
Sous des visages de tout âge, le même esprit bohème.

Le rouge et le vert sont par excellence
les couleurs de la guinguette.
Le rouge, c’est celui des nappes
de “Chez Gégène”, des cerises que les Parisiens allaient cueillir
sur le chemin des guinguettes à l’époque romantique.
Le vert, c’est celui de l’herbe, des tonnelles,
de l’eau des étangs où paressent les plantes aquatiques. Des couleurs
de la nature, des couleurs de fête, que l’on retrouve sur les lampions
bariolés.
![]()
![]()
![]()
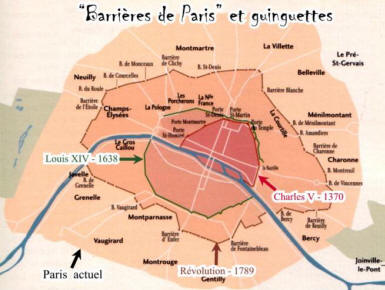
1577 : Arrêt du parlement - règle des 20 lieues - qui favorise la création de guinguettes au-delà du périmètre d’imposition parisien fixé par Louis XIII.
Au
XVIe siècle, le “guinguet” désigne en Champagne et en Picardie un
vin blanc aigrelet. Les Parisiens appellent aussi guinguet le vin des
mauvaises années, et plus généralement le vin vert des environs de
Paris.
Une piquette bon marché dont se grisent les bals populaires
proches de la capitale. On apprécie d’autant plus ces vins
euphorisants, que l’eau des puits de Paris est polluée...
L'histoire
des guinguettes suit le cours de celle du vin. La production vinicole
des bourgeois est concurrencée par celle du peuple, de piètre qualité
et de moindre prix, qui approvisionne les cabaretiers de la capitale.
Tout
change lorsqu’en 1577, un arrêt du parlement interdit aux cabaretiers
parisiens d’acheter du vin dans les alentours de la capitale.
Plutôt
que de payer les “droits d’entrée”, ceux-ci émigrent au-delà du
périmètre imposable, renforcé par des barrières où est perçu
l’impôt.

Tavernes, tripots et maisons de prostitution se casent
dans les faubourgs, qui commencent ainsi à se développer. Les premières
guinguettes, qui ne sont encore que des débits de boissons, y prospèrent.
Le
dimanche, le petit peuple se presse dans les oasis hors barrières afin
de
s’abreuver de vin détaxé.
1675 - 1680
:
Développement
des guinguettes de barrière.
Les
guinguettes sont nées derrière les barrières.
Elles s’épanouiront à partir des années 1675 dans les quartiers
entourant Paris : la Pologne, les Porcherons, la Nouvelle France et la
Courtille.
C’est
au siècle des lumières que les guinguettes allument leurs lampions. On y
boit et on y danse, mais il est rare que l’on y mange, car souper hors
de chez soi n’est pas encore usuel.
Au
milieu du XVIIIe siècle, les guinguettes qui font parler d’elles sont
celles des Porcherons, de la Courtille, Ménilmontant, Vaugirard,
Montrouge, Gentilly, Charonne et Champs-Elysées.
1784 - 1790
:
Construction du mur des Fermiers Généraux, qui incite les
guinguettes à s’établir au-delà du nouveau périmètre d’imposition.
Les
Porcherons sera le quartier
des guinguettes jusqu’à la construction du mur des Fermiers Généraux
(1784-1790). Ce mur fiscal englobe les zones qui s’urbanisent et les
lieux de plaisir.
La ligne de métro Nation-Barbès-Etoile en épouse
le tracé. Il est percé
Guinguettes et bals champêtres se multiplient alors dans les 24
communes qui entourent la ville.
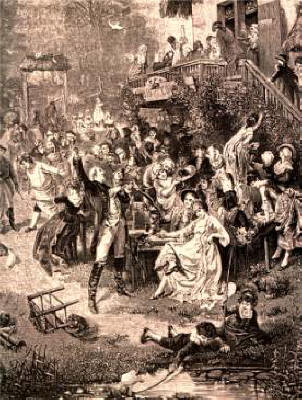
Pour
approvisionner ces guinguettes hors barrières, qui attirent la
population des faubourgs et de la ville, le vignoble d’Île-de-France
va augmenter sa production.
L’abus
du vin, considéré comme un aliment, est communément accepté par
les dirigeants de l’époque.
“Combien de pauvres familles
allaient souper en hiver à la guinguette !
Ils y trouvaient un vin
naturel et à bas prix, des comestibles infiniment moins chers
1789 : Abolition de la règle des 20 lieues.
1837 : Première ligne de chemin de fer :
Paris-Saint-Germain-en-Laye.

Les femmes reviennent de la guinguette avec des
brassées de fleurs ou des paniers de fruits.
Les bourgeois vont à
Montmorency en voiture ou à cheval pour y faire une partie d’âne au
milieu des cerisiers.

À leur suite, les citoyens plus modestes
viendront en chemin de fer. Les loueurs d’ânes attendent les
Parisiens dans un joyeux tohu-bohu pour les emmener se gorger de
cerises, puis les entraîner dans les guinguettes manger une omelette
au lard.
Celles-ci n’ouvrent qu’en fin de semaine, spécialement pour
eux.
Nos citadins enfiévrés de campagne dansent sous les arbres de
la châtaigneraie, animée de chevaux de bois, de balançoires, de tirs
et de restaurants.
1830 -1860
: Vogue des guinguettes de Belleville, Montmartre, Neuilly, Montrouge,
et d’une façon générale des abords de Paris.
Les guinguettes vivent leur âge d’or au XIXe siècle. La banlieue s’industrialise.
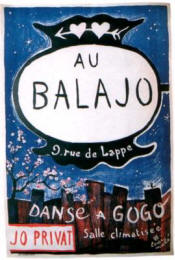

Suivant le déplacement des industries, une partie de la population ouvrière, et donc de la clientèle de guinguette, s’éloigne dans la nouvelle banlieue.
1860 : Annexion des faubourgs à la capitale, qui repousse les bals en dehors de la ville.
L'annexion des faubourgs à la capitale en 1860 repousse les bals au-dehors des murs de la ville.
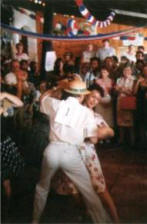

Les guinguettes de Belleville (barrières de la Courtille, des Trois Couronnes, de Ménilmontant et des Amandiers), mais aussi de Montrouge (barrières d’Enfer, du Maine et du Montparnasse) et de Bercy, battent leur plein durant le XIXe siècle, et surtout sous le second Empire.
1840-1850 : Développement du canotage et essor des guinguettes des bords de Marne et de Seine.
 Le
canotage apparaît dès 1825 autour du Pont-Royal et
dérive ensuite vers Bercy et Suresnes. Alphonse Karr et Théophile
Gauthier en seront les pionniers.
Le
canotage apparaît dès 1825 autour du Pont-Royal et
dérive ensuite vers Bercy et Suresnes. Alphonse Karr et Théophile
Gauthier en seront les pionniers.
Maupassant et Mallarmé prendront le
relais.
Après 1835, la création des chemins de fer de l’ouest puis
de l'est au départ de Saint-Lazare encourage largement la mode. Les wagons déversent un lot impressionnant de canotiers en maillots
rayés.
La folie du canotage gagne toutes les couches de la population.
On glisse sur l'eau à bord des barques et des yoles, c'est le petit
canotage. On laisse le vent souffler dans les voiles : c'est le grand
canotage.
1870 : Siège de Paris et déclin des guinguettes.
Années
1880 :
Disparition de plusieurs guinguettes des bords de Seine.

1906
:
Le con
Les plus ouvrières
se contentent du sol nu et d’un simple accordéon.
En 1906, elles
voient arriver un flot d’employés et d’ouvriers, tout éberlués de
leurs congés dominicaux tout neufs. Premières bicyclettes, premières
automobiles... les Parisiens partent au vert le jour du Seigneur.
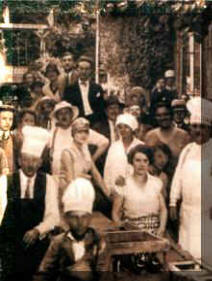
Quand on ne pique-nique pas au bois de Chaville ou de Meudon, on guinche
dans les guinguettes au bord de l’eau, à Saint-Cloud, à Chatou, sur
l’île de la Jatte, à Joinville ou à Nogent. Celles des bords de
Marne et de Seine sont les plus en vue.
Chez Gégène, on peut venir
avec ses provisions. Couvert, verrerie et attractions sont
fournis pour le prix de la boisson.

1908-1910 : Succès des guinguettes de Montparnasse.
Dans les années 1908-1910, les peintres désertent Montmartre pour Montparnasse, quartier jusque-là peu recherché et bien achalandé en guinguettes, qui sera en vogue jusqu’à la Seconde Guerre.

Années
1920
: Essor des studios de cinéma à Joinville-le-Pont, qui contribueront
à la notoriété des guinguettes de la Marne aux dépens de celles de
l’ouest parisien et des bords de Seine. Arrivée de l’automobile.
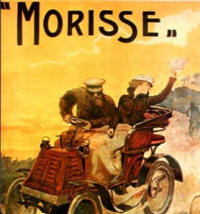 Les
années frou-frou... Les années 20...
Les
années frou-frou... Les années 20...
En 1918, le préfet de police
autorise la réouverture des bals, interdits pendant la guerre.
On danse
à nouveau dans les bals musette de Charonne et de la Montagne, dans les
guinguettes de barrière et les bosquets de banlieue. Depuis l’arrivée
des Américains en 1917, le jazz commence à se faire entendre, au désespoir
des Auvergnats, fidèles au musette. Émile Vacher, créateur du genre
musette, flirte aussi avec le fox-trot.
La ligne Bastille-La Varenne,
“le train du plaisir”, met les guinguettes de la Marne sur les rails
du succès, alors que celles de la Seine, plus isolées, sombrent dans
l’oubli.
Entre les 2 guerres,
les guinguettes de l’ouest parisien qui s’industrialise sont délaissées
au profit de celles des bords de Marne, stimulées par le cinéma des
studios de Joinville, qui les rendront immortelles.

Les cinéastes
comprennent la beauté faubourienne des pavés et des terrains vagues de
banlieue, et installent leurs studios à la périphérie de Paris :
Joinville, mais aussi Epinay, Saint-Maurice, Boulogne.
On
chuchote que les cinéastes de La
Belle Equipe et de Casque d’Or
posèrent leurs caméras au Petit Robinson. Les studios étant à
2 pas, au bout de la rue de Joinville, il est probable que les
acteurs se restaurèrent, voire tournèrent, dans toutes les guinguettes
du coin.
Les vacances se démocratisent après la Première Guerre. Le chemin de fer baisse ses prix et le peuple déserte à son tour la capitale pendant l’été. 1936 : les bals musette connaissent leur apogée avec la semaine de 40 h et les premiers congés payés. Monsieur Hulot va pouvoir partir en vacances...
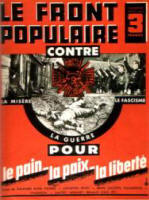
C’est la victoire du monde ouvrier, le Front
populaire.
Les lois se succèdent : conventions collectives, congés payés de 2
semaines, semaine de 40 h.
Léon Blum dira alors : “Il est
revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie.” Un espoir
incarné par le cinéma de Renoir ou de Duvivier, où l’on voit
petits bourgeois et ouvriers courir les bals champêtres.
Quel
naufrage a fait couler les guinguettes d’antan ? À la Belle Époque,
400 guinguettes s’échelonnaient le long de la Marne, de
Lagny à Charenton. En 1939, le musette atteint son apogée.
Mais nous
sommes à la veille de jours sombres et d’une drôle de guerre... À la
mobilisation, les guinguettes posent encore une fois leurs violons et
leurs accordéons.
L’occupant fait fermer les établissements
dansants, sonnant ainsi le glas des guinguettes.
La fête est finie
!
Années 50 : Renouveau des guinguettes, vogue du swing.
Dans les
années 50, l’euphorie de la danse reprend. Succès des guinguettes,
avec leur simplicité bon enfant.
Mais l’accordéon reste dans son étui, car la musique à la mode: c’est
le swing !
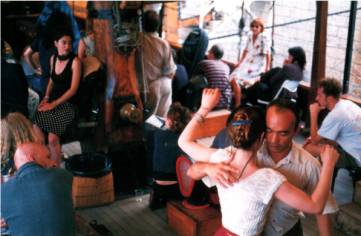
Années 70 : Désaffection des guinguettes par le public.
Après
la pluie, le beau temps. On reprend d’anciens établissements.
C’est le cas du Petit Robinson à Joinville ou de la maison
Fournaise, à l’abandon près de 40 ans et rouverte par la mairie de
Chatou en 1990.
On en crée de nouveaux. Comme le Martin Pêcheur à
Champigny-sur-Marne. Les patrons de restaurant les plus prévoyants,
sentant le souffle de la crise, ont lancé leur formule guinguette
vers 1993. Ils savent qu’aujourd’hui, il faut offrir un “plus”...
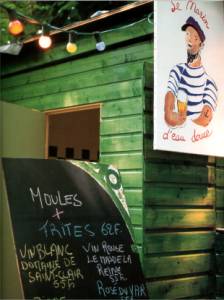
Les
guinguettes revivent ! Surtout depuis 1992, lorsque l’association
Culture Guinguette se met en tête d’orchestrer leur regain. Et en
fanfare puisque toute la presse, nationale et régionale, la suit.
À
l’origine de cette initiative, un programme visant le réaménagement
des bords de Marne et de Seine.
Mais l’association voit loin, jusqu’aux bords de Loire ou de Saône. Concerts, charte de qualité, appel aux pouvoirs publics, “Culture Guinguette” réinsuffle la vie dans les guinguettes de France.
| De nouveau les guinguettes chantent à tue-tête ! |

