|
L’œuf
brouillé parfait
En
cuisant 1 œuf dans un four à une t° intermédiaire entre
celles de coagulation du jaune et du blanc, l’on obtiendra
un œuf nouveau.
Un œuf qui cuit est un de ces "miracles quotidiens" que nous
ne voyons plus : la transformation d’un liquide jaunâtre et
transparent en un solide blanc et opaque n’est-elle pas un
phénomène remarquable ?
Cette prise est une gélification thermique : les protéines
qui constituent 10% du blanc d’œuf se lient, formant un
réseau continu qui piège l’eau du blanc en un "gel"
chimique.
C’est ce phénomène que l’on va examiner.
La théories de la prise en gel a des pères prestigieux :
ainsi, le physicien écossais Thomas Graham proposa en 1861,
une classification des systèmes physiques divisés que sont
les aérosols, émulsions, suspensions…
Parmi ces "colloïdes" (du grec kolla, la colle), Graham
inclut les gels que forment l’acide silicique hydraté,
l’alumine hydratée, l’amidon, la gélatine, le blanc d’œuf,
etc. À cette époque la gélification semblait s’apparenter à
la cristallisation d’un corps à partir d’une solution
sursaturée, et l’on ne faisait pas de distinction entre les
substances naturelles, telles la pectine ou la gélatine, et
les solutions concentrées de composés inorganiques
insolubles, tel le sulfate de baryum.
Progressivement, les physiciens découvrirent que l’état de
gel était associé à la formation d’un réseau continu, dans
le liquide.
Dans les années 1940, la théorie de la gélification
progressa doublement. D’une part le physicien américain P.
Hermans proposa une classification des différents type de
gels (séparant les agrégats de particules sphériques, les
réseaux de fibres ou de particules allongées, les gels
physiques de polymères, les gels chimiques faits de fils
souples liés par des liaisons covalentes) ; d’autre part,
J.D. Ferry étudia la constitution des gels de protéines :
autrement dit, le blanc d’œuf coagulé. Ferry supposa
notamment que la coagulation résultait d’une double
réaction : d’abord , les protéines, pelotes repliées sur
elles-mêmes, se déroulent ("dénaturation") ; puis les
protéines déroulées s’associent en réseau ("agrégation").
Les vitesses de ces 2 étapes déterminent les
caractéristiques du gel : Ferry proposa que, si l’agrégation
est plus lente que la dénaturation, les gels formés sont
moins opaques et plus fins que les gels formés avec une
grande vitesse d’agrégation.
Dans les années 1970, à Göteborg, Anne-Marie Hermansson a
testé ces prévisions en explorant les conditions qui
favorisent la dénaturation, telles qu’un pH élevé ou bas :
les charges électriques que portent alors les protéines
favorisent les interactions entre ces dernières et les
molécules du solvant (c’est à dire la dénaturation), mais
réduisent l’agrégation : elle confirma qu’un gel plus
ordonné se forme si l’agrégation est plus lente que la
dénaturation, donnant aux protéines dénaturées le temps de
s’orienter avant l’agrégation ; ce gel est moins opaque et
plus élastique que ceux dont l’agrégation n’est pas ralenti.
Inversement, quand l’agrégation et le dénaturation sont
simultanée, un gel opaque et moins élastique se forme.
En cuisine, faire
simple !
Comment utiliser ces théories en
cuisine ?
Le cuisinier qui a maîtrisé les points précédents risque
d’être désemparé par la complexité du blanc d’œuf qui
contient 10% de protéines que sont l’ovotransferrine, l’ovomucoïde,
le lysosyme, l’ovalbumine, les globulines ; le jaune d’œuf,
lui, contient des protéines liées à du cholestérol (LDL et
HDL), des livertines, de la phosvitine…
Quelles sont les températures de dénaturation de toutes ces
protéines ?
Là encore, la réponse est embarrassante : ces protéines se
dénaturent respectivement à 61, 70, 75, 84,5, 92,5, 70, 72,
70, 80, 62 et + de 140°C.
Comment se tirer d’embarras ?
Par l’expérience.
Mettons du blanc d’œuf dans un récipient en verre que l’on
chauffe par le fond : à l’aide d’une sonde, on mesure alors
la t° à laquelle le blanc, liquide jaunâtre et transparent,
s’opacifie et durcit : ± 62°C.
Les données précédentes montrent que c’est vraisemblablement
l’ovotransferrine qui assure cette coagulation initiale.
Pour le jaune, on obtient de la même façon une t° de 68°C.
Aux t° supérieures, lorsque plusieurs protéines ont coagulé,
la consistance durcit, parce que les réseaux associés à
chaque protéine coagulée tiennent mieux la phase liquide.
Dans un four préchauffé à 65°C, plaçons 1 verre avec un
blanc d’œuf, 1 verre avec un jaune d’œuf, 1 verre avec le
blanc et le jaune mélangés, et 1 œuf entier dans sa
coquille. Attendons quelques heures (1 ou 2 de + ne
changeront rien au résultat, pour peu que les verres aient
été recouverts d’un film plastique, qui évitera
l’évaporation de l’eau et le croûtage des préparations),
puis sortons les échantillons et observons.
Le blanc est pris (puisque la t° de 65°C est supérieure à la
t° de 62°C préalablement mesurée), mais il est encore
laiteux, très délicat et pas caoutchouteux comme dans les
œufs durs trop cuits.
Le jaune lui est liquide : si la livetine gamma a une t° de
coagulation de 61°C, sa concentration n’est pas suffisante
pour faire prendre le liquide. Et l’œuf entier, dans sa
coquille, se laisse écaler, puis verser dans un bol :
superbe masse laiteuse, coagulée mais tendre, de forme
parfaitement régulière, dont le jaune a conservé un goût
puissant de jaune frais et non un goût d’omelette ou d’œuf
dur.
Enfin le verre qui contient le mélange de jaune et de blanc
est pris, et nous obtenons des œufs brouillés parfaits, sans
grumeaux.

Le cuisinier
parisien Pierre Gagnaire en a fait un plat, qu’il a nommé "Œufs
brouillés de la Cité" :
- Dans une tasse, mettre jaune et blanc avec un peu de sucre
et un peu de vanille ; enfourner à 65°C et, lorsque la masse
est prise, sortir et servir avec un coulis d’abricots un peu
acide.
Bon appétit.
|

![]() Brouillade aux truffes
Brouillade aux truffes 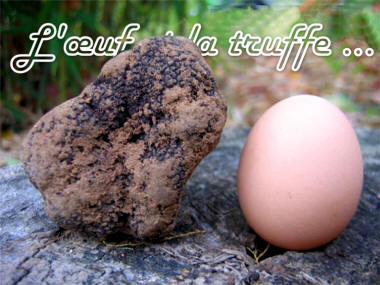

 Déguster avec un Pomerol à 15°c !
Déguster avec un Pomerol à 15°c !

 La
réussite des œufs brouillés, réside dans une montée
progressive de la T°. Une chaleur excessive au départ
coagule trop vite les œufs et nuit à la texture.
La
réussite des œufs brouillés, réside dans une montée
progressive de la T°. Une chaleur excessive au départ
coagule trop vite les œufs et nuit à la texture.
 Quelques conseils au néophyte
afin d'utiliser au mieux le précieux tuber melanosporum
(truffe noire du Périgord).
Quelques conseils au néophyte
afin d'utiliser au mieux le précieux tuber melanosporum
(truffe noire du Périgord). Cela est vraiment étonnant, le parfum pénètre l’intérieur de
l’œuf.
Cela est vraiment étonnant, le parfum pénètre l’intérieur de
l’œuf. 