
![]() Artichauts à la bretonne
Artichauts à la bretonne

Cette recette classique
et régionale devra être préparée
avec de gros artichauts camus bretons.
Des artichauts, une sauce qui
s'apparente à une béchamel mais riche en crème fraîche
une recette assez simple et délicate, une autre manière de déguster les
artichauts bretons.
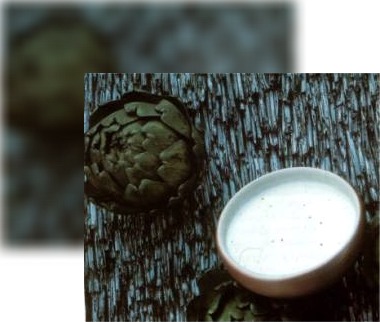
Ingrédients pour 6 convives
-
6 gros artichauts
-
50 g de beurre ½ sel
-
50 g de farine
-
250 g de crème fraîche épaisse
-
Noix de muscade
-
Sel & Poivre
Indications de préparation
-
Chauffer plusieurs litres d’eau salée dans une grande marmite.
-
Pendant ce temps, couper les tiges des artichauts, puis bien les laver en écartant les feuilles.

-
Les plonger dans l’eau qui bout et les laisser cuire pendant 40 min en maintenant l’ébullition.
Les égoutter tout de suite et conserver 50 cl d’eau de cuisson pour la sauce. -
Dans une casserole, fondre le beurre sur feu doux.
Dès qu'il grésille, verser la farine dedans et remuer avec une cuillère en bois afin que le mélange devienne mousseux.
Verser le jus de cuisson d’un seul coup en remuant sans arrêt jusqu’à épaississement. -
Saler, poivrer, râper un peu de noix de muscade, puis ajouter la crème fraîche juste avant de servir avec les artichauts tièdes, que l’on consomme en les effeuillant.
|
|
|
Apparition des dictons
culinaires
La figure
montre les précisions recueillies dans 348 livres de cuisine
français, publiés entre 1310 et aujourd’hui, en fonction de
la robustesse ainsi calculée de différentes recettes. |
L'artichaut

D'abord remède, il fut réputé guérir de la
mélancolie...
Cette fleur comestible, originaire de Sicile est populaire depuis
longtemps dans le Midi. L'artichaut devint à la mode et fit son
entrée officielle dans la cuisine à l’époque de la Renaissance, sous
l’influence italienne. Il est dit que Catherine de Médicis faillit
mourir d’une indigestion d’artichauts, dont elle raffolait ! Elle en
imposa la mode à la cour et bientôt la France s'engoua...
Cultivé en France depuis le XVIe
siècle, il s’est particulièrement bien adapté en Bretagne.
La Bretagne produit les beaux et gros artichauts ronds, le Midi
fournit les violets, plus petits et plus fins, dont certains si
tendres qu’on peut les manger crus. C’est un légume d’été que l’on
trouve sur tous les marchés à partir du mois de mai.
La noix de muscade
Myristicaceae

Originaire de l’île
Banda – Archipel des Moluques. Graine d’un arbre odorant de 6 à 15 m
de haut, avec une flaveur très épicée, résineuse, à odeur de noix
fraîche, et une saveur brûlante et âcre.
Les noix de muscade
toujours râpées sont employées pour relever des plats assez fades,
comme les soufflés, la sauce béchamel et la purée de pommes de
terre. Elles aromatisent des viandes blanches, des ragoûts, des
fondues, des poissons sardines), des pâtés, boudins), des légumes,
des potages (soupe à l'oignon) et des sauces destinées à accompagner
les viandes et les omelettes. Elles sont incorporées également dans
des gâteaux, des cakes, des biscuits, des tartes aux fruits, des
gâteaux au miel et au citron, des soufflés sucrés, des compotes de
fruits, des entremets à la vanille et des confiseries. Il convient
de doser cette épice avec soin pour éviter de masquer les arômes
assez subtils des fruits. La muscade donne son arôme au vin chaud
sucré.
Elle entre dans la fabrication de certaines liqueurs
(Chartreuse) et de certains apéritifs (Vermouth). La muscade est
présente dans des mélanges d'épices. Elle s'associe en particulier,
au poivre, au clou de girofle et à la vanille.

 Une
étude des dictons, proverbes, pratiques culinaires semble
révéler que les recettes qui risquent de rater sont les plus
abondamment décrites.
Une
étude des dictons, proverbes, pratiques culinaires semble
révéler que les recettes qui risquent de rater sont les plus
abondamment décrites.


