
![]() Aubergines frites
Aubergines frites
Patlican kizartma
|
Mezze & Ouzo
Représentatifs de la table grecque, les
mezze (hors
d'œuvre) sont des classiques du répertoire
gastronomique. Faciles à |

Ingrédients pour 4 convives
-
3 Aubergines fermes
-
4 Tomates mûres
-
8 Gousses d’ail
-
Quelques branches de persil
-
10 Cl de vinaigre de vin
-
1 Pincée de sucre semoule
-
15 Cl d’huile d’olive
-
Sel & poivre
Indications de préparation
-
Laver les 3 aubergines et trancher les extrémités.
Les éplucher en “zèbre”, soit 1 bande sur 2 dans le sens de la longueur, et les couper en 2, toujours en longueur. -
Laisser tremper ces lamelles dans 2 litres d'eau salée durant 30 min.
-
Pendant ce temps, laver les 4 tomates, les épépiner puis les couper en dés.
-
Éplucher les gousses d'ail et les émincer finement.
-
Laver le persil, l’équeuter et le hacher grossièrement.
-
Sortir les lamelles d'aubergines de leur eau de trempage et les sécher dans le panier à salade.
-
Mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle.
-
Lorsqu'elle est bien chaude, frire les lamelles d'aubergines jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
-
Les égoutter sur du papier absorbant. Réserver.
-
Verser l'huile restante dans la poêle. Mettre et laisser cuire les tomates en dés et l'ail émincé.
-
Arroser avec le vinaigre et ajouter le sucre, le sel et le poivre.
-
Lorsque les tomates sont réduites en purée, les verser sur les aubergines.
-
Laisser refroidir et décorer avec le persil plat.

|
|

L'aubergine

Ce gros fruit violet, lustré, à la peau lisse,
pousse sur de hautes plantes rigides, ramifiées, aux branches
souvent épineuses, et aux grandes feuilles légèrement duveteuses.
Ses fleurs, violettes, ressemblent à celles de la pomme de terre et
naissent à l’aisselle des feuilles.
L’aubergine, parfois appelée "mélongène", est
blanche ou ivoire dans sa forme immature et ressemble à des œufs.
Native d’Inde, la belle aubergine ''Solanum melongana'', inconnue
des Grecs et des Romains, elle n’est mentionnée pour la première
fois qu’au Ve siècle, dans les anciens écrits chinois.
Importée par les Arabes en Espagne, elle commença à être connue près
de la Méditerranée au XIIe siècle. Elle fut cultivée en Italie, dès
le XVe siècle. et n’atteignit la France qu’au XVe siècle. Elle resta
peu appréciée en dehors du Midi, jusque bien avant dans le XVIII
siècle.
Elle ne fut largement cultivée qu’à partir du XIXe siècle et ne fit
son apparition sur nos tables qu’à la fin du XXe siècle. En dehors
des spécialités régionales, elle fut plutôt traitée comme une
curiosité, et les recettes sont peu nombreuses.
Sa carrière récente connaît aujourd'hui le même succès que le
poivron.

L'ail

Depuis l’Égypte antique, l’ail est apprécié pour
ses vertus médicinales : il entrait déjà dans la composition de 22
des 800 potions décrites dans le ''Codex Ebers'', un papyrus rédigé
1550 ans avant notre ère.
Remède universel à l'époque de Ramses II. Les bâtisseurs de
pyramides recevaient 1 gousse d'ail par jour pour ses propriétés
toniques...
Autrefois, à Draguignan, ses gousses étaient rôties sur les feux de la Saint-Jean allumés dans toute la ville, avant d’être ensuite partagées entre tous les habitants.
La tomate

Découverte au Mexique, poussant dans le maïs, de
la même famille que la mandragore, la tomate provient des montagnes
péruviennes où elle a longtemps été cultivée. Importée en Occident
par les Espagnols il y a 400 ans.
Autrefois la tomate était dorée, rarement rouge. Les premiers fruits
étaient profondément ridés et aplatis. La variété de ''Marmande''
est encore assez plate. La tomate était considérée comme vénéneuse
et fut longtemps cultivée comme une simple fleur pour la beauté de
ses fruits rouges. On l’appelait aussi, pomme du Pérou et pomme
d’acacia. Son nom vient de l’aztèque ''tomati''. Baptisée pomme
d’amour dans le Midi, et pomodoro : ''pomme d’or'' en Italie. Les
premières tomates furent observées dans le Nord en Italie en 1554
puis se développa ensuite dans le reste de l’Italie... Gêne, Nice,
puis le Sud de la France et la Corse.
Elle apparut dans le Nord de la France et à Paris après 1790. Elle
ne se répandit réellement au nord de la Loire qu’à la faveur de la
Révolution française.
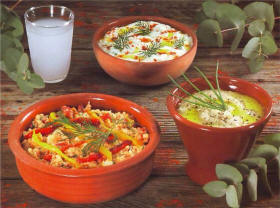
 réaliser, ces spécialités sont idéales à découvrir l'été
entre amis à l'heure de l'apéritif : Taramosalata, olives,
féta, tzatsiki, légumes frits...
réaliser, ces spécialités sont idéales à découvrir l'été
entre amis à l'heure de l'apéritif : Taramosalata, olives,
féta, tzatsiki, légumes frits...
