
Clair de lune
Avec ce cocktail, côtoyer l'Exception... discrètement.
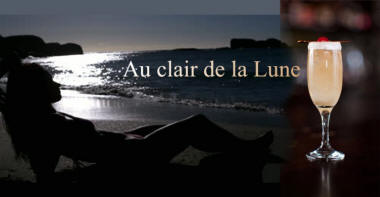
Ingrédients
-
5/10 de Jus de pamplemousse
-
2/10 de Brandy - Cognac par ex.
-
1/10 de Cointreau
-
2/10 de Champagne brut
Indications de préparation
-
Verser les ingrédients dans un shaker avec quelques cubes de glace.
-
Frapper.

-
Servir dans les flûtes, puis allonger le mélange de Champagne Brut.
-
Décorer d’1 tranche de pamplemousse.

The O.M.S recommends that women abstain during pregnancy and that if they choose to drink, they should drink no more than 1 or 2 units of alcohol once or twice a week and should not get drunk.
|
Lorsque
l’on prépare les cocktails directement dans le verre, verser
toujours les alcools les moins forts
en premier, sauf indication contraire. |
|
Le champagne, une histoire de bulles...
Les bulles de champagne naissent surtout dans les fibres textiles, qui restent sur la paroi du verre... La science ne démontre rien, car sa mission - la recherche des mécanismes des phénomènes - n’est pas la production de théories, mais la réfutation de "modèles", sorte de simplification de la vérité : paradoxalement, ce travail de sape conduit au progrès de la connaissance ! Un cas d’école est l’étude des bulles de champagne.
On a commencé par
comprendre que les bulles naissaient à la surface des
verres. Puis cette idée a été précisé, par l’observation de
quelques bulles sur les éventuels "voltigeurs", ces
particules qui sont parfois en suspension dans le breuvage
effervescent. Sic itur ad astra Une équipe de Saint-Gobain Recherche en 2003, avait étudié la surface des verres, à la recherche d’éventuels défauts du verre, où seraient nées les bulles : on imaginait des crevasses… telles les gravures, faites intentionnellement celles-ci au fond des verres.
En réalité, le travail effectué à Saint-Gobain Recherche avait montré que la surface du verre est lisse (à l’échelle considérée) et que les bulles semblaient naître sur des particules minérales (tartrates, carbonates) ou sur des fibres textiles. Dans ce nouveau modèle (toujours faux, c’est une antienne), on imaginait que les dépôts minéraux et les fibres de tissu formaient les aspérités nécessaires à la croissance des bulles.
L’emploi d’une caméra
ultrarapide a réfuté à nouveau le modèle : au Laboratoire
d’œnologie de Reims, fut démontré que les croissances de
bulles se font surtout, non pas sur les fibres, mais dans
celles-ci : les fibres textiles sont creuses, et le
versement du champagne dans les flûtes où ces fibres sont
venues se coller aux parois laisse des poches dans les
fibres. Les fibres, essentielles Ces fibres doivent être considérées comme des ensembles de microfibrilles, où le gaz dissous dans le liquide diffuse. Il vient alors enrichir les bulles coincées dans les fibres, de sorte que les poches de gaz de l’intérieur des fibres (il y a généralement 1 poche par fibre) grossissent et finissent par "déborder" des fibres : 1 bulle se détache alors, laissant une poche de gaz dans la fibre, qui peut à nouveau grossir et engendrer une bulle. Tout cela en quelques millisecondes ! Comment la bulle se détache-t-elle de la poche de gaz restée dans la fibre ? La théorie n’est pas aboutie, mais une hypothèse serait que joue l’effet Rayleigh (du nom du physicien anglais), selon laquelle une interface telle que celle qui sépare le champagne du gaz se minimise. C’est, à l’envers, le même que celui qui dissocie une gaine régulière de rosée déposée sur un fil d’araignée, au petit matin, en une succession de gouttelettes : la surface totale eau/air est inférieure quand les gouttelettes sont formées. Ici, la surface est réduite lorsque la bulle se forme. Détachée, la bulle monte enfin vers la surface.
Les mystères, toutefois ne
sont pas moindre.
Suivant un processus connu
des physiciens, le gaz carbonique emprisonné dans le vin
n'aspire qu'à se libérer : 80 % s'échappent de manière
invisible par la surface libre ; les 20 % restant forment
des bulles qui remontent à la surface. |
Le brandy

Brandy est un terme de langue anglaise désignant
une eau-de-vie.
Il vient du néerlandais brandwijn signifiant "vin
brûlé".
Isolé, ce terme s'applique plutôt à une eau de vie de raisin
tels que : cognac, armagnac, rakia, Vecchia Romagna, etc...
Associé à un nom de fruit il désigne un spiritueux provenant de ce
fruit, par ex. apricot brandy, cherry brandy...
Le Cointreau
Liqueur française aux
oranges. C’est un curaçao ou triple sec. Au milieu du XIXe siècle,
Édouard Cointreau, fils d’un producteur de liqueurs d’Angers, se
rendit pour affaires dans la colonie hollandaise de Curaçao.
Il y découvrit une orange amère dont le parfum lui parut prometteur
et fit expédié une grosse quantité de zestes séchés à Angers… Plus
tard afin d’éviter la confusion avec les contrefaçons, la famille
Cointreau donna son propre nom à sa liqueur.
Il fit vite le bonheur des amateurs de liqueurs cristallines et de
cocktails de toutes sortes. Profitant de son implantation à Angers,
pas très loin du port de Nantes, le Cointreau remonta la Loire afin
de s'exporter rapidement.

Aujourd'hui, 80% de la production part pour l'étranger. La formule de fabrication demeure secrète. On sait seulement que cette excellente liqueur est à base d'écorces d'oranges amères et d'oranges douces séchées. La bouteille carrée de couleur ambrée est présente dans tous les bars du Monde, et la liqueur est utilisée dans de nombreuses spécialités pâtissières...
 de
citron, puis les retourner sur une soucoupe contenant du
sucre ou du sel fin pour les cocktails à base de tequila.
de
citron, puis les retourner sur une soucoupe contenant du
sucre ou du sel fin pour les cocktails à base de tequila. Le
mécanisme aurait été le suivant : le versement du champagne
dans les verres aurait laissé des poches de gaz, dans ces
crevasses et fissures. Or la pression de ce gaz égale à la
pression atmosphérique, est inférieure à la pression du
dioxyde de carbone dissout dans le liquide ; aussi le
dissous aurait migré vers ces poches, qui auraient gonflé,
formant finalement des bulles qui se seraient détachées. Le
détachement de ces bulles laissant du gaz dans les fissures,
du gaz dissout serait revenu enrichir les poches, formant
ainsi une nouvelle bulle, et ainsi de suite…
Le
mécanisme aurait été le suivant : le versement du champagne
dans les verres aurait laissé des poches de gaz, dans ces
crevasses et fissures. Or la pression de ce gaz égale à la
pression atmosphérique, est inférieure à la pression du
dioxyde de carbone dissout dans le liquide ; aussi le
dissous aurait migré vers ces poches, qui auraient gonflé,
formant finalement des bulles qui se seraient détachées. Le
détachement de ces bulles laissant du gaz dans les fissures,
du gaz dissout serait revenu enrichir les poches, formant
ainsi une nouvelle bulle, et ainsi de suite…
 Ne
pas manquer de la contempler lors de la prochaine
dégustation du breuvage attribué à Pierre Pérignon : l’on
verra que le mouvement des bulles n’est pas vertical. En
effet le mouvement d’une bulle dans le liquide perturbe ce
dernier, qui dévie la bulle suivante du train de bulles
partant d’une fibre particulière.
Ne
pas manquer de la contempler lors de la prochaine
dégustation du breuvage attribué à Pierre Pérignon : l’on
verra que le mouvement des bulles n’est pas vertical. En
effet le mouvement d’une bulle dans le liquide perturbe ce
dernier, qui dévie la bulle suivante du train de bulles
partant d’une fibre particulière.



